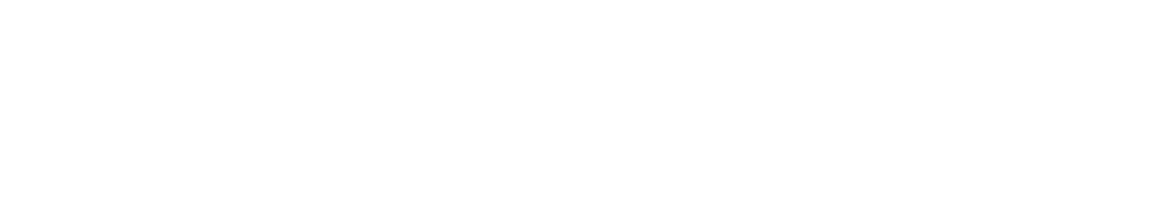Trieste, une ville transfrontalière
Description
[Extrait]
Trieste est une ville transfrontalière en raison de sa position géographique, de sa destinée politique, de son climat culturel. Située à la frontière nord-est de l’Italie, Trieste est depuis toujours un pont entre l’Europe occidentale et l’Europe centrale et orientale. Puisqu’elle est baignée par la mer adriatique, elle a maintenu un rapport important avec l’ensemble de l’aire méditerranéenne, balkanique, du Machrek et du Maghreb. L’histoire a fait de Trieste une ville latine, avant de la faire devenir autrichienne et enfin italienne. Différentes communautés y cohabitent, dans un voisinage qui, s’il n’a pas toujours été facile, est de nos jours collaboratif et pacifique. Déjà Chateaubriand avait fait de Trieste une ville frontière ou, comme il écrivait, « le dernier souffle de l’Italie » avant d’entrer dans un monde que l’écrivain français, en partance pour l’Orient, qualifiait de « barbare ». Une idée semblable de frontière indépassable est développée par Paul Morand qui, en 1971, consacre de très belles pages de Venises à la ville qu’il va élire comme sa dernière demeure. En plein milieu de Guerre froide, Trieste devient le bastion de l’Europe occidentale contre l’empire soviétique. Ville frontière donc entre l’Est et l’Ouest, l’Orient et l’Occident, la vie et la mort. Mais ville dont la frontière est à dépasser et dont les alentours vivent dans un rapport de continuité – diversité avec le centre. Trieste n’était qu’un port, sous la plume de Carlo Goldoni qui, dans ses Mémoires, originairement écrits en français, avant de devenir la ville culturelle où la Mitteleuropa se termine et s’exalte. La complexité de Trieste était d’ailleurs déjà présente dans les belles pages que Charles Yriarte lui consacre au cours des années 1870. Le voyageur français, assez aimé et lu par Jules Verne, décrit un paysage pittoresque, mais foncièrement mélangé : une ville allemande pour son administration, mais italienne pour son « charme » ; « utilitaire » pour sa vie commerciale, mais douée d’une « grâce accomplie » pour son paysage humain animé ; « orientale dans le choix des couleurs » et nouvellement italienne pour « l’excès » qui la caractérise. Si Trieste est donc un microcosme, de même que l’a défini Claudio Magris, à savoir une image réduite du monde et de la société, le passage du transfrontalier au transculturel nous semble automatique. De fait, les Triestins ont répondu à la cohabitation de façon différente au cours des siècles, mais l’habitude à se confronter avec autrui a fait de Trieste un centre où les diversités culturelles sont mises en valeur et sont analysées avec respect et intérêt. Ce milieu pluriculturel constitue, depuis toujours, un berceau d’études qui, faute de toujours appartenir institutionnellement à ce que l’on définit en Italie comme les « letterature comparate », développe une perspective critique similaire à l’approche de cette discipline.
Collection
Contenus liés
| Trieste (Italie) |
| Goldoni, Carlo (1707-1793) Au total, Carlo Goldoni a écrit en 20 ans plus de 200 pièces d’importances diverses et dans différents genres : tragédies, intermèdes, drames, livrets d’opéra ou saynètes de carnaval ; ses comédies, écrites après 1744, assurent sa célébrité. |
| Magris, Claudio (1939-....) |
Titre
Trieste, une ville transfrontalière
Titre Alternatif
in revue "L'illisible", TRANS- [En ligne], 21 | 2017
Créateur
Éditeur
Revue TRANS- [En ligne], 21 | 2017
Revue le littérature générale comparée
Date
05/04/2017
http://journals.openedition.org/trans/1602
Langue
Source
Droits
Non libre de droits